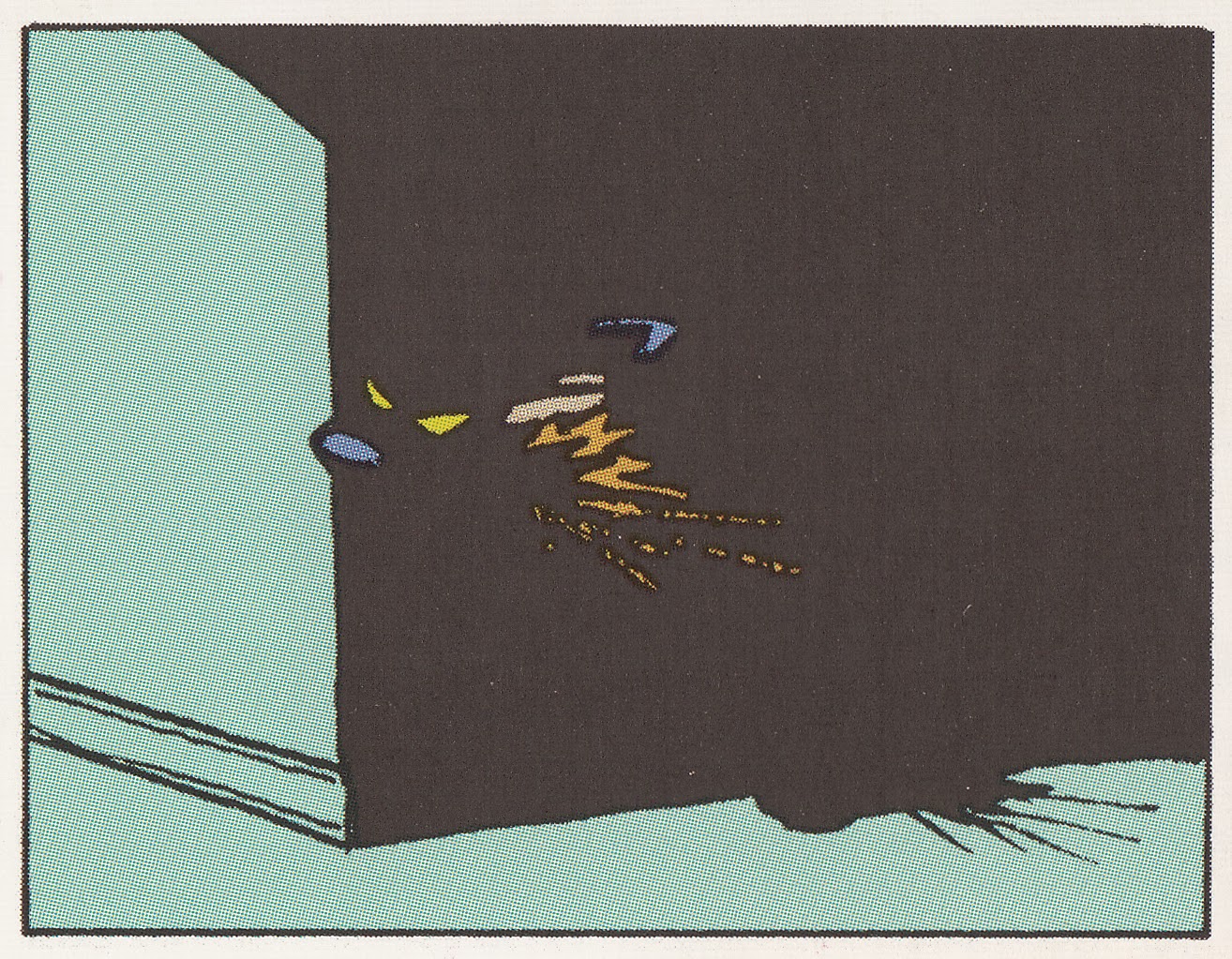A la suite du billet de la semaine dernière, Abel Lanzac, Christophe Blain et Clémence Sapin nous montrent que donner un nom de famille à un personnage change complètement la donne.
Abel Lanzac & Christophe Blain & Clémence Sapin, Quai d'Orsay, Dargaud.
L'extrait ci-dessus est bien une des
rares fois où les personnages s'appellent par leurs prénoms. Ils font tomber
les barrières diplomatiques et se laissent aller à de grandes claques sur
l'épaule. Ils sont plus intimes et moins distants. Ils sont mignons.
Pour le lecteur, ça marche pareil : que le personnage n'ait qu'un prénom (ou un
surnom) (comme « Pim », « Pam »,
ou « Poum »), et il se sent proche de lui (dans l'extrait ci-dessus, on est amusé par le côté humain des personnages qui nous paraissent soudain plus sympathiques). Qu'on lui rajoute un
nom de famille, et une certaine distance se crée : le nom de famille rend le
personnage plus réel et il est plus difficile pour le
lecteur de s'y identifier.
C'est d'ailleurs pile ce que recherchent
les auteurs en collant un nom de famille à un personnage : si le fait que le
personnage évolue dans le vrai monde réel a son importance, les
auteurs ne vont plus s'en sortir avec des espèces de pseudonymes
chelous, il va falloir que le personnage porte un vrai nom.
Et par un vrai nom, il faut parfois entendre un vrai nom de famille.
Et par un vrai nom, il faut parfois entendre un vrai nom de famille.
LE PLUS SIMPLE EST ENCORE DE LEUR DONNER DE « VRAIS NOMS QUI SONNENT COMME DANS LA VRAIE VIE ».
(Basique, mais efficace.)
Même les enfants ont droit à un nom de famille ! Pas de familiphobie, ici !
Marion Duval a un père, qui a un métier (journaliste), une ville bien connue (Paris) (intra-muros) (on ne se refuse rien), et des lieux d'explorations parfaitement identifiés (la Loire, la côte Atlantique, la Grèce, etc...).
C'est que Marion voyage dans le vrai monde. Une maison et une famille ne suffisent plus à planter le décor de ses aventures. Elle arpente un univers plus vaste, moins générique, et plus précis (un petit plan de l'île d'Ithaque pour bien se repérer dans Attaque en Ithaque, des intrigues sur des faussaires et donc des questions de réalisme dans Le manuscrit de Saint-Roch et L'homme aux mouettes).
Comme elle vit des aventure plus réelles, Marion a besoin d'un nom de famille, comme les vrais gens de la vraie vie.
Chose encore plus maligne : on veut la contextualiser ? On l'appelle « Marion Duval ». On veut la rapprocher du lecteur ? On l'appelle « Marion ». (Une opposition nom/prénom similaire à celle dans l'extrait de Quai d'Orsay.)
POUR ÊTRE CLAIR (NAN, PARCE QUE JE SENS BIEN QUE VOUS SUIVEZ MOYEN) :
Quand on donne un nom de famille à des personnages, ce n'est jamais innocent. C'est qu'on veut les inscrire dans un certain contexte réel ou réaliste, et qu'on va ensuite utiliser ce contexte dans l'intrigue du bouquin (oui, non, parce que sinon, autant pas s’embêter).
Ça c'est de la doc ! Ça c'est du journalisme ! Prends-en de la graine, Christophe Barbier !
(Et arrêtes de lire the Economist, tu nous fais du mal !) (Ça marche aussi avec le Parisien.)
(Et arrêtes de lire the Economist, tu nous fais du mal !) (Ça marche aussi avec le Parisien.)
Une vision ethnologique saisissante ! (Et des photos pour tout bien expliquer avec des flèches.)
POUR ÊTRE CLAIR (NAN, PARCE QUE JE SENS BIEN QUE VOUS SUIVEZ MOYEN) :
Quand on donne un nom de famille à des personnages, ce n'est jamais innocent. C'est qu'on veut les inscrire dans un certain contexte réel ou réaliste, et qu'on va ensuite utiliser ce contexte dans l'intrigue du bouquin (oui, non, parce que sinon, autant pas s’embêter).
Dans le choix de ces noms de famille, il faut bien sûr faire attention, malgré tout, à ce que ceux-ci restent relativement neutres, doux à l'oreille, peu connotés. Sinon, très vite, le piège se referme.
ET NOUS TOMBONS DANS LE CAS DES « VRAIS NOMS QUI SONNENT TELLEMENT VRAI QU'ILS SONNENT POURRIS ».
On pourrait par exemple parler des personnages de Tardi.
Ils ont tous des noms moisis, les personnages de Tardi.
« Esperandieu », « Mouginot », « Dugommier », « Flageolet », « Georgette Chevillard », c'est vraiment n'importe quoi.
Et c'est très moche.
Mais c'est fait exprès.
De cette manière, on plonge dans une ambiance début du XIX° siècle (« Georgette ») avec des personnages ridicules aux noms ridicules (les personnages sur lesquels Tardi ne tape pas sont rares, dans Adèle Blanc-sec). Ce n'est pas grave qu'on ne s'identifie pas à eux. De toute façon, ils ne sont pas aimables. Il ne sont pas fait pour mettre en branle des mécaniques d'identification. Ils sont faits pour qu'on se moque d'eux.
ET NOUS TOMBONS DANS LE CAS DES « VRAIS NOMS QUI SONNENT TELLEMENT VRAI QU'ILS SONNENT POURRIS ».
On pourrait par exemple parler des personnages de Tardi.
Ils ont tous des noms moisis, les personnages de Tardi.
« Esperandieu », « Mouginot », « Dugommier », « Flageolet », « Georgette Chevillard », c'est vraiment n'importe quoi.
Et c'est très moche.
Mais c'est fait exprès.
De cette manière, on plonge dans une ambiance début du XIX° siècle (« Georgette ») avec des personnages ridicules aux noms ridicules (les personnages sur lesquels Tardi ne tape pas sont rares, dans Adèle Blanc-sec). Ce n'est pas grave qu'on ne s'identifie pas à eux. De toute façon, ils ne sont pas aimables. Il ne sont pas fait pour mettre en branle des mécaniques d'identification. Ils sont faits pour qu'on se moque d'eux.
Tout est dans le titre ! Ils ne sont pas aimables, on vous dit...
Il a un nom mi-moche, « Brindavoine ». Un nom très marqué, mais pas trop grotesque. Un nom mi-figue mi-raisin. Et, de fait, Tardi a une vision mi-figue mi-raisin du personnage.
Du coup, fondamentalement, il est un peu ridicule, « Brindavoine ».
Mais comme il a fait la guerre et qu'il en a chié...
...il est quand même sympathique.
Avec toujours ce côté vieille France que contient le nom.
C'est important, le côté vieille France, pour Tardi.
Mais foin de mi-moche ! De figue ! De raisin ! Parfois, c'est le drame !
PARFOIS, LE NOM EST POURRI SANS QUE CE SOIT FAIT EXPRÈS.
PARFOIS, LE NOM EST POURRI SANS QUE CE SOIT FAIT EXPRÈS.
On a donc le-nom-à-la-noix-mais-qui-pose-le-personnage-bourgeois, puis/et/nonobstant le-prénom-court-diminutif-cool-et-sympa-parce-que-le-personnage-est-ami-et-même-un-peu-plus-avec-l'héroïne.
Dans la même page, se côtoient le passé carrément princier du personnage, et la négation de cette facette.
Les auteurs gagnent sur les deux tableaux en utilisant un nom réaliste qui renseigne sur les qualités du personnage et un surnom/prénom qui rapproche le personnage du lecteur, autant que le personnage se rapproche de Marion (j'étais très jaloux de cet abruti, quand j'avais son âge).
Le nom de famille pourri n'est donc pas forcément une fatalité, mais peut être transformé en avantage si l'auteur est subtil.
Il y a malgré tout un cas particulier dans cette catégorie des noms pourris. Ceux qu'on ne choisit pas et qui résistent à la subtilité des auteurs parce qu'il leur est imposé puisqu'il s'agit d'un personnage historique.
CE QUI NOUS AMÈNE A LA NOUVELLE CATÉGORIE : LES « VRAIS NOMS QUI SONNENT POURRIS, CERTES, MAIS COMME CE SONT LES NOMS DE VRAIS GENS DE LA VRAIE VIE, ON N'A PAS VRAIMENT LE CHOIX ».
Sans aller jusqu'à disséquer les soucis qu'a pu rencontrer une auteure (certes pas exempte de reproches) lorsqu'elle a voulu réaliser une biographie de « Benoîte Groult », on peut essayer de se concentrer sur les noms historiques présents dans Astérix.
Nous voilà donc avec des personnages aux noms les plus abracadabrants.
Jeu et interactivité. Saurez-vous reconnaître :
« Ordralfabétix », « Alavacomgetepus », « Encorutilfaluquejelesus », « Liric », « Satiric », « O'Torinolaringologix », « Zebigbos » ?
Et tout ces gens fréquentent des « Jules César », des « Scipion », des « Pompée », des « Cléopâtre », des « Brutus », « Alésia », « Gergovie », les révoltes d'Espagne, l'invasion de la Grande-Bretagne ; enfin, bon, bref, des tas de trucs.
Astérix est une bande dessinée qui cherche les contrastes entre l'Histoire (les noms réels des personnalités historiques) et ses personnages (les noms fictifs et fantaisistes des personnages auxquels on s'attache), pour en faire ressortir les caractères. Donc c'est parfaitement cohérent. Bravo les artistes.
MAIS, SI CELA N'AVAIT PAS ÉTÉ LE BUT DES AUTEURS ?
Dans ce cas, les auteurs auraient pu faire en sorte que le héros ne rencontrent jamais de personnages politiques, ou simplement leur aide de camp, ou encore des mecs-que-l'histoire-n'a-pas-retenu-et-sur-lesquels-ont-n'arrête-pas-sa-lecture, ou encore des simili-César-mais-avec-un-autre-nom.
C'est d'ailleurs ce que font Lanzac & Blain dans Quai d'Orsay.
Premier avantage : le lecteur ne peut quand même pas s'empêcher de penser que c'est inspiré de faits réels (comme on dit) et que donc, oui, bon, d'accord, ce ne devait pas être exactement comme ça, mais un peu quand même... Il s'établit des parallèles avec les faits historiques qui enrichissent la fiction. (Un peu comme dans Quai d'Orsay, quand on découvre que Cole et Worms, Powell et Villepin, sont amis.) (Ou quand, dans Astérix, on a des dialogues entre Brutus et César.) Un second degré apparaît dans le récit.
Deuxième avantage : on ne s'embête plus avec la vrai vérité ; c'est de la fiction ; les auteurs ont le droit de prendre leurs aises pour rendre le récit plus attractif et manipuler les faits.
Troisième avantage : comme les personnages sont fictionnalisés, ils peuvent aussi être bande dessinééisés (à dire dix fois très vite). Leurs actes autant que leurs aspects physique sont tirés vers des particularités qui facilitent la narration de la bande dessinée.
Cet aspect est rendu évident quand les physiques des personnages principaux sont tirés vers la caricature pour en faire des silhouettes (un aspect que Blain adore utiliser dans toutes ses bandes dessinées).
Puisque Blain fait de la musculation, je ne tirerais aucunes conclusions sur ce qu'essayerait éventuellement de compenser quiconque en cartoonisant ses personnages et leurs nez.
Cette caricature n'est pas que superficielle. Par exemple, ci-dessous, le comportement fanfaron de « Taillard de Worms » (et sa manie de passer voir son équipe en coup de vent) facilitent les ellipses.
Pas besoin de montrer machin qui rentre, un coup de vent et il est là.
Un effet poussé au maximum, parce que c'est plus rigolo.
Bref : si des auteurs ont comme contrainte d'utiliser des personnalités-vraies-d'aujourd'hui-ou-d'hier, il faut encore une fois en faire un atout en modelant ces personnages (dans leurs personnalités, dans leurs actes, et jusque dans leurs noms) pour pouvoir les utiliser à bon escient (comme un vrai personnage de bande dessinée et de fiction, chez Blain et Lanzac ; comme un référent historique qui contraste avec les gros nez des gaulois, chez Uderzo et Goscinny).
Une rotondité de nez qui ne trompe pas sur le rôle du personnage, entre Astérix et Jules, Chesterfield et le cousin.
BREF, BREF, BREF...
Dans ce cas comme dans les autres, il s'agit de jouer du contexte.
Un contexte réel ? Un nom réel.
Un contexte historique ? Un nom qui sonne vieille France, ou vieille Gaule, ou je sais pas quoi...
Un contexte politique ? Un nom un peu différent (pour transformer l'homme publique en personnage) mais qui ne détone pas.
TOUT ÇA, C'EST TOUJOURS LA MÊME CHOSE !
Le but est de jouer de références extérieures, réelles (des noms qui font penser à d'autres pays) ou fictionelles (des noms qui font penser à d'autres récits) pour, à chaque fois, installer une ambiance, un contexte, une identité particulière.
- Des noms qui posent une ambiance « America, Fuck Yeah ! » avec « Alan Smith », « Jack Shelton », « Steve Rowland », « Jason Fly », « Jason Mac Lane » et des SPOILERS partout dans les deux images qui suivent.
Van Hamme, Vance, Petra, XIII - Secret Defense, Dargaud.
- Une ambiance étrange, balkanique mais familière, avec « Alcide Nikopol », « Jill Bioskop », « Ivan Vabek ».
Enki Bilal et la Eierkrieg dans La femme piège, Les humanoïdes associés.
- Une ambiance de récit d'aventure réactualisé, avec « Naim », « Maïmounia », « Günter », « Jean-Philippe», et « Ali » (des noms similaires à ceux de Corto, Bouche dorée, Steiner, Tristan).
Benjamin Flao, Kililana song, Futuropolis.
- Une ambiance de conte du chat perché, avec « Philémon », « Félicien », et « Monsieur Barthélémy » (des noms communs mais un peu désuets).
Fred, Philémon - L'enfer des épouvantails, Dargaud.
Les auteurs essayent à tous les coups de trouver des noms qui inspirent et correspondent à une ambiance de récit.
Qui dit récit réaliste dit nom de famille.... Mais quand il s'agit d'histoires qui concernent des souris qui portent des jupes ou des grooms qui chassent en Palombie, ça ne colle plus... Plus qu'un contexte réaliste, il faut alors planter une ambiance de douce fantaisie, et utiliser les noms qui vont avec...
CE SONT CES NOMS QUE J'ESSAYERAI DE DÉCORTIQUER LA SEMAINE PROCHAINE.
(PROMIS, CETTE FOIS-CI, JE NE DÉPASSERAI PAS, J'AI DIT QUE JE NE FERAI PLUS QU'UN POST SUR LE SUJET, ET JE N'EN FERAI PLUS QU'UN.)






































.png)